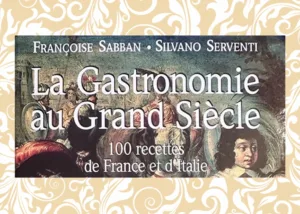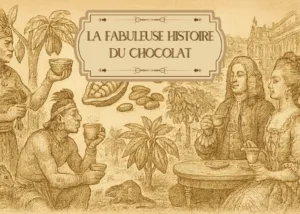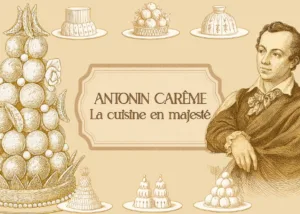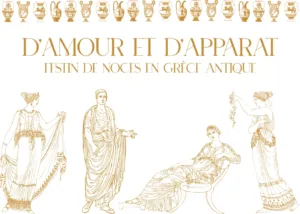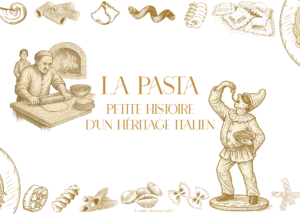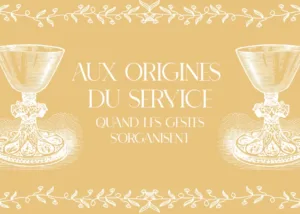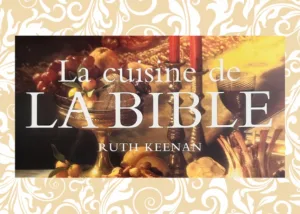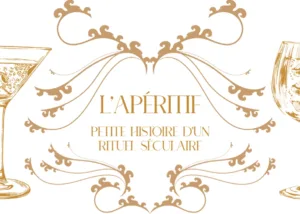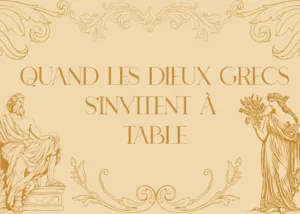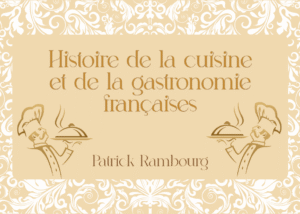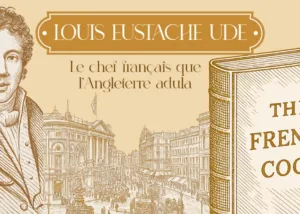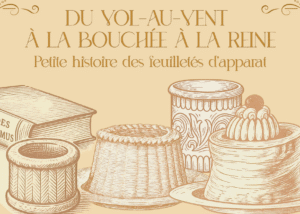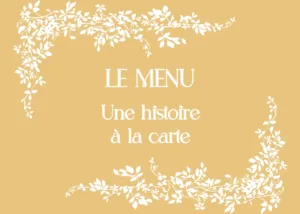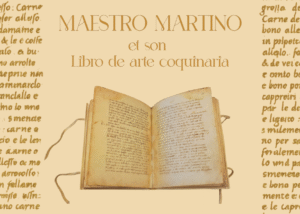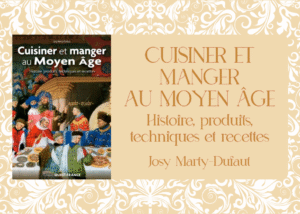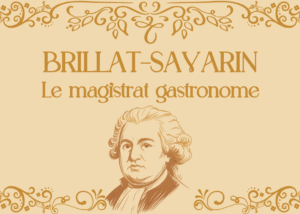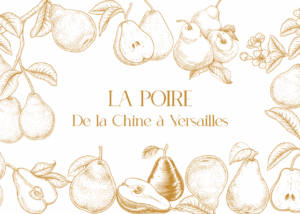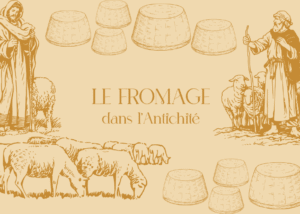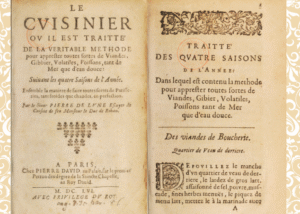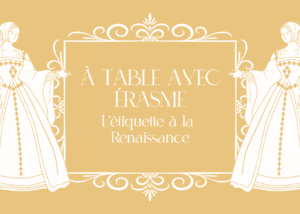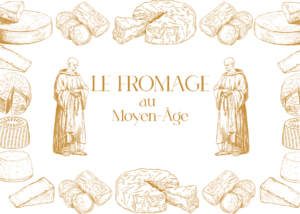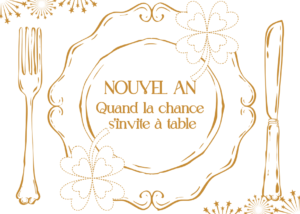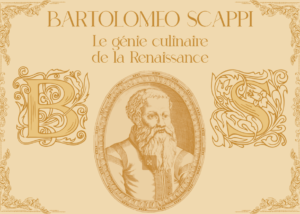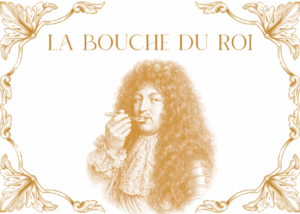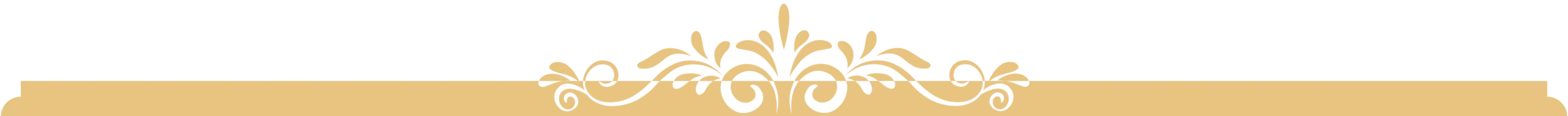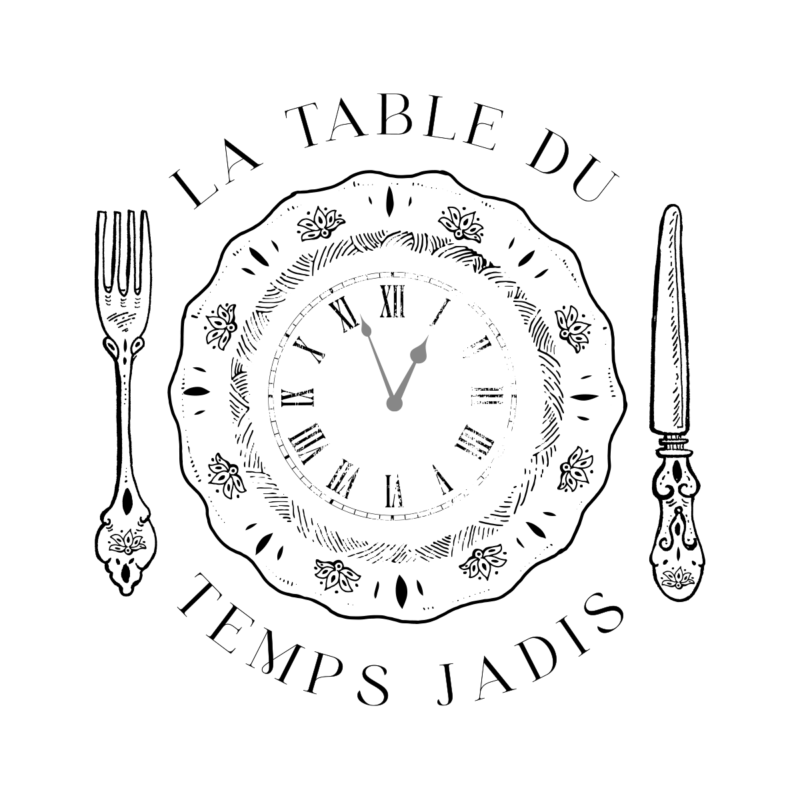L’apéritif
petite histoire d’un rituel séculaire
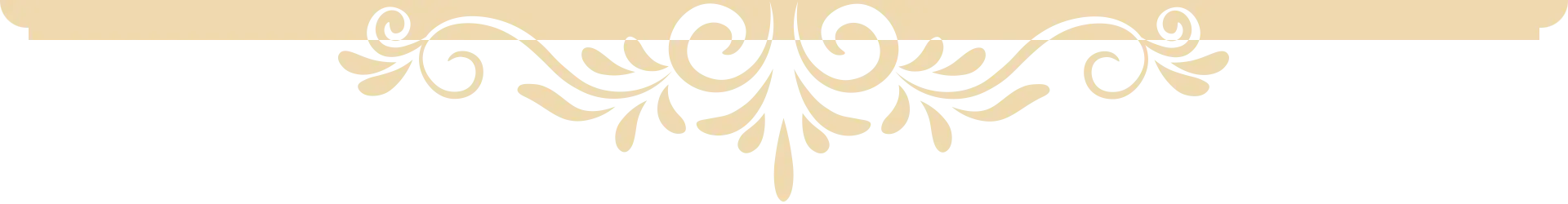
Il précède le repas comme une ouverture d’opéra : quelques notes, un bruissement de verres, une promesse de plaisirs à venir. Héritier d’un lointain remède médicinal, l’apéritif est devenu l’un des rites les plus vivaces de l’art de vivre européen — de Turin à Toulouse, de Venise à Paris. À travers ses métamorphoses – potion amère, élixir exotique, cocktail mondain, « apéro » convivial – il raconte cinq siècles de médecine, d’industrie, de colonisation et de sociabilité partagée.

L’art d’ouvrir l’appétit : une tradition plurimillénaire
Bien avant que le mot n’apparaisse, les Romains avaient leur propre boisson d’ouverture. Lors de la coena, le repas commence par la gustatio, une série de promulsis — petites bouchées salées ou sucrées : olives, dattes farcies, œufs, salades, fruits de mer — servies avec du mulsum, un vin sucré mêlé de miel, de poivre, parfois d’épices orientales ou de pétales de fleurs. Ce breuvage aux accents suaves est censé stimuler l’appétit, réchauffer le corps et éveiller les sens. Ce premier geste marque déjà un art de vivre collectif, où la table devient un théâtre du lien social.
Le mot « apéritif » vient plus tard du verbe latin aperire (« ouvrir ») et désigne d’abord une préparation médicinale : elle ouvre les voies digestives et prépare l’estomac. Dans l’Europe médiévale, cette fonction se perpétue à travers les vins épicés, comme le claré ou l’hypocras, élaborés avec du vin, du miel et des épices comme la cannelle, le gingembre ou le clou de girofle. Servis tièdes ou frais, ces breuvages sont réputés réchauffer l’estomac et susciter l’appétit.
Le Mesnagier de Paris (1393) conseille d’en boire avant un repas copieux, ou pour fortifier le corps. D’autres préparations, à base d’anis, d’angélique ou de fenouil, sont également réputées ouvrir l’appétit, notamment dans les cercles monastiques. Si leur amertume reste marquée, le sucre et le miel viennent l’adoucir, amorçant lentement le glissement vers un plaisir gustatif.
Au XVIIIᵉ siècle, l’Encyclopédie classe toujours l’« apéritif » parmi les médicaments. Jean-Jacques Rousseau, dans une lettre à Malesherbes (1762), cite même un lait d’ânesse qu’il juge « presque apéritif » : preuve que la frontière entre médecine et plaisir commence à s’effacer. L’amertume médicinale s’adoucit, et l’apéritif, sans le dire encore, entame sa mue hédoniste.

De la médecine au plaisir : l’apéritif s’émancipe
Le basculement s’opère de l’autre côté des Alpes. À Turin, Antonio Benedetto Carpano met au point, en 1786, un vermouth de vin blanc infusé d’armoise, cannelle et girofle – bientôt imité par Cinzano, qui adapte sa production aux goûts de l’époque.
Au début du XIXᵉ siècle, Grimod de La Reynière érige le « coup d’avant » en rituel codifié : une lampée de kirsch, de genièvre ou de vermouth, bue d’un trait pour « creuser l’estomac » et ouvrir le bal d’un repas en trois actes.
En 1813, Joseph Noilly fonde la maison Noilly Prat, pionnière du vermouth sec à la française. Il marie des vins blancs du Languedoc à une infusion d’herbes des Pyrénées (angélique, coriandre, centaurée, camomille…), selon une méthode originale d’oxydation à l’air libre en fûts de chêne. Ce vin fortifié, à l’amertume élégante, devient l’un des premiers apéritifs de dégustation, ouvrant la voie à un style distinct du vermouth italien.
En 1846, le chimiste Joseph Dubonnet crée un vin de quinquina pour prévenir le paludisme dans les colonies nord-africaines ; son amertume atténuée par des épices en fait la coqueluche des officiers, puis des cafés parisiens.
À Milan, Gaspare Campari élabore en 1860 un bitter rouge vif, inspiré des toniques médicinaux amers. Il assemble alcool, écorces d’orange, quinine et plantes alpines selon une recette tenue secrète. Servi pur ou allongé, le Campari devient rapidement emblématique des cafés italiens, avec son goût intense et sa couleur flamboyante.
Trois ans plus tard, en 1863, la maison Martini & Rossi entre dans la course avec ses vermouths plus doux, au profil aromatique raffiné, qui séduisent rapidement une clientèle internationale.
L’industrie de la distillation, la conquête coloniale et la généralisation du sucre transforment la potion en boisson de plaisir. L’absinthe – à 45 ° ! – inquiète les médecins ; en 1926, Maurice Letulle dénonce une « maladie sociale »… tout en recommandant quand même de « déglutir l’apéritif à jeun ».
Plus tonique que thérapeutique, l’apéritif entre officiellement dans la sphère publique : on le déguste désormais pour le goût et pour le rituel.

Terrasses, affiches et cocktails : l’apéritif devient spectacle
À la Belle Époque, l’apéritif quitte la sphère privée pour s’afficher au grand jour. Sur les boulevards parisiens, les verres s’alignent en terrasse, brillent sous la lumière du soir, reflètent les robes claires et les panamas. Maupassant évoque ces « liqueurs mélangées d’eau, infusions faites avec toutes les nuances d’une boîte d’aquarelle ». Dans les cafés, l’heure de l’apéritif devient une chorégraphie urbaine, entre le tintement des verres et le ballet des garçons de café.
L’époque est aussi celle de l’explosion visuelle. Les affiches Art nouveau glorifient les marques naissantes – Suze, Byrrh, Dubonnet – qui transforment leurs produits en icônes graphiques. Dans Un Bar aux Folies-Bergère (1882), Manet capture l’instant : une barmaid, des bouteilles, et toute la société en reflet dans un miroir.
Mais c’est le cocktail qui donne à l’apéritif une nouvelle allure. Lancé dans les salons parisiens par le prince de Galles (futur Édouard VII), il devient synonyme de raffinement cosmopolite. On y marie vermouths, spiritueux coloniaux, amer, jus d’agrumes. Le shaker, nouveauté venue des États-Unis, remplace la cuillère : on ne prépare plus, on performe. Les barmen deviennent artistes, et les recettes — Dry Martini, Manhattan, Americano — voyagent des clubs anglais aux cafés de la rive droite.
Le rituel se codifie. On l’accompagne de grignotages salés : cacahuètes d’Afrique de l’Ouest, olives espagnoles, conçus pour faire saliver et prolonger l’instant. Le verre devient un manifeste, le moment un art de vivre.

Du zinc au salon : l’apéritif s’invite chez soi
Au tournant du XXᵉ siècle, l’apéritif commence à franchir le seuil des cafés pour s’installer dans les intérieurs bourgeois. Petit à petit, les vitrines se garnissent de verres ciselés, les tables basses accueillent biscuits salés et olives, et le rituel s’ancre dans la sphère privée. À partir des années 1950, avec les Trente Glorieuses, la convivialité se déplace dans le salon : l’art de recevoir chez soi devient le symbole d’un bien-être moderne, porté par la croissance et l’aménagement des foyers. C’est l’époque des buffets de fête, des toasts au tarama, des verres de porto et de muscat servis avec soin.
Les goûts se régionalisent : le pastis s’impose dans le Sud, la gentiane dans les Alpes, et l’Italie voisine apporte ses propres traditions. L’une d’elles va conquérir le monde : le Spritz.
Pour retracer la longue histoire de cette boisson, il faut remonter à la fin du XVIIIᵉ siècle, au temps de la domination autrichienne en Lombardie-Vénétie. Les soldats austro-hongrois, peu habitués à la vigueur des vins italiens, commencent à les adoucir en y ajoutant de l’eau gazeuse. Ce geste donne naissance au premier Spritz, dont le nom vient du verbe allemand spritzen, « pulvériser ». Un mélange simple de vin blanc et d’eau pétillante — que certaines régions du Frioul servent encore tel quel.
Au début des années 1900, l’apparition des siphons à eau de Seltz permet d’ajouter les bulles de manière plus pratique et régulière. Mais le cocktail tel qu’on le connaît aujourd’hui ne voit le jour que dans les années 1920, lorsqu’on ajoute au mélange une touche de bitter : amer, coloré, parfumé — il donne au spritz sa couleur flamboyante et sa signature aromatique.
Aujourd’hui, l’apéritif moderne se décline sur tous les tons : sans alcool ou mixologique, entre amis ou en famille, dans un jardin ou sur un rooftop. Il reste un moment-charnière, suspendu entre jour et nuit, où l’on trinque au plaisir d’être ensemble.
Du vin épicé des banquets romains à la douce amertume du spritz, l’apéritif retrace une longue histoire de médecine, de goût, de conquête et de convivialité. Il a troqué sa blouse de pharmacien contre l’élégance d’un rituel social. En levant nos verres, nous prolongeons un geste ancien : ouvrir l’appétit… mais aussi la conversation, et le plaisir d’être ensemble.

Retrouvez les autres articles du blog
Retrouvez les autres articles du blog