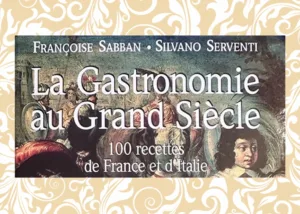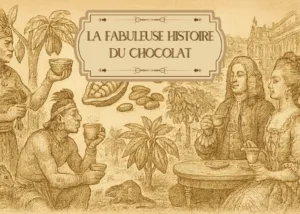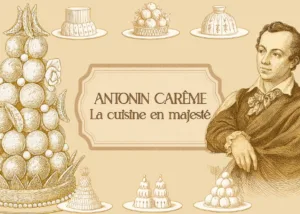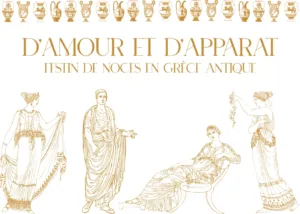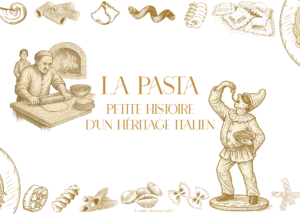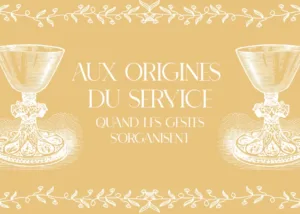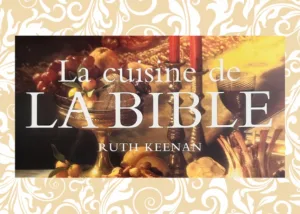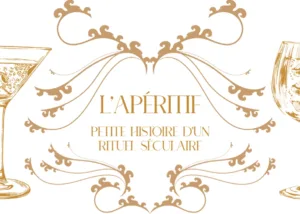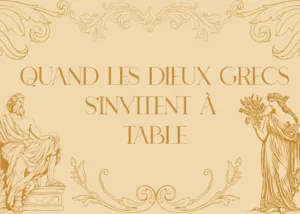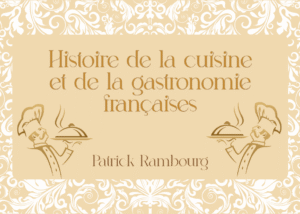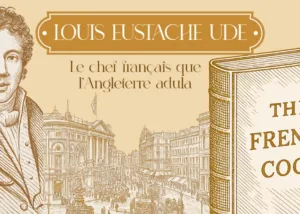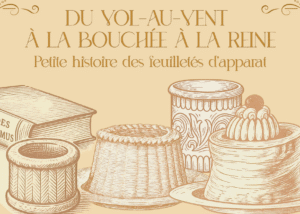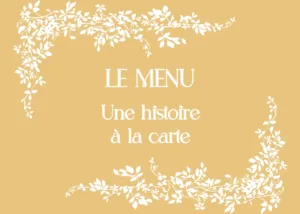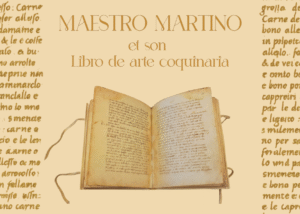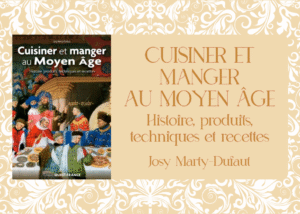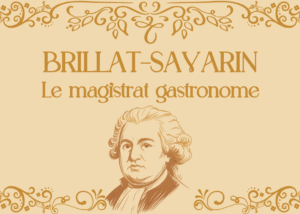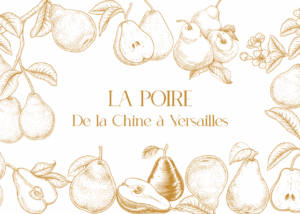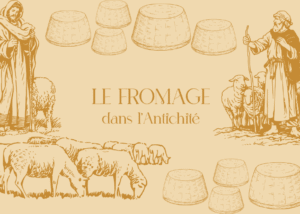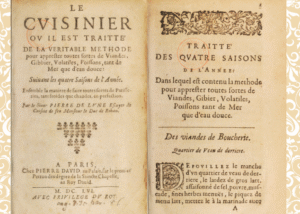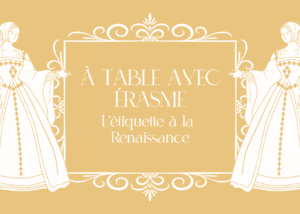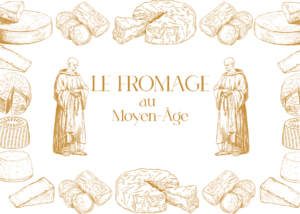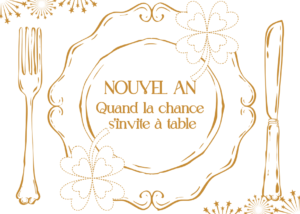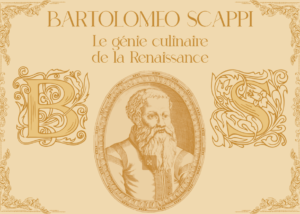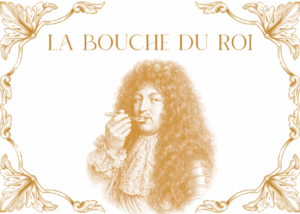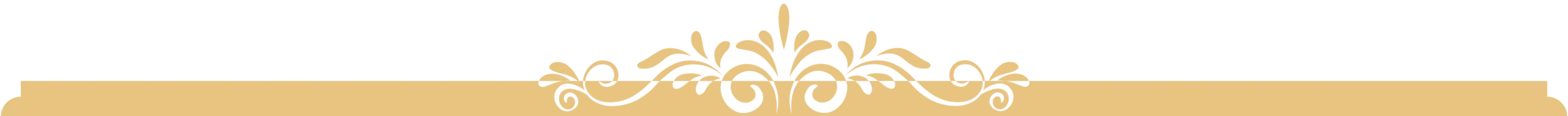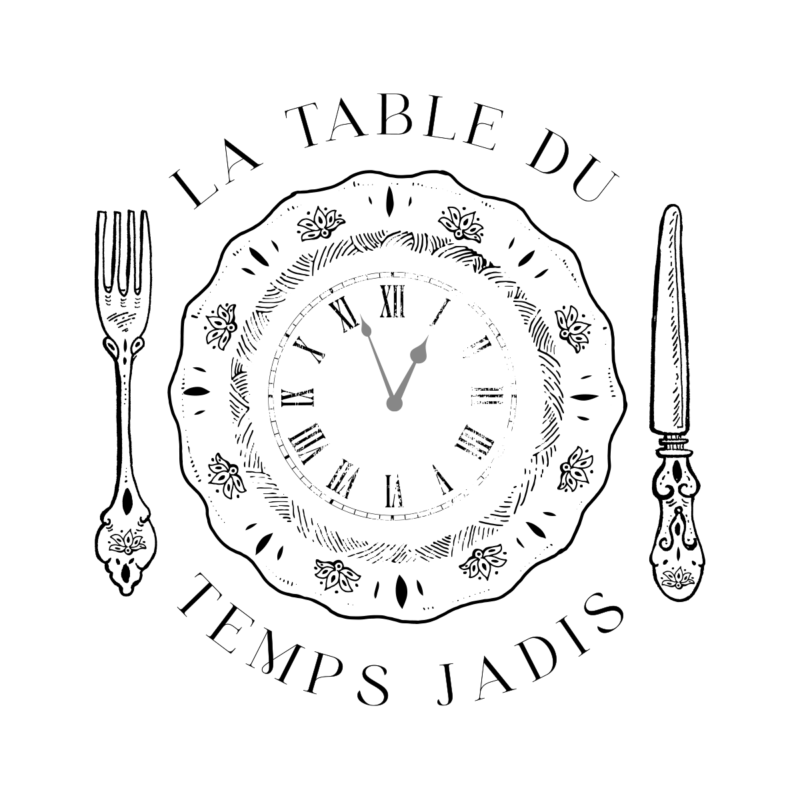Le menu, une invention moderne
Petite histoire à la carte
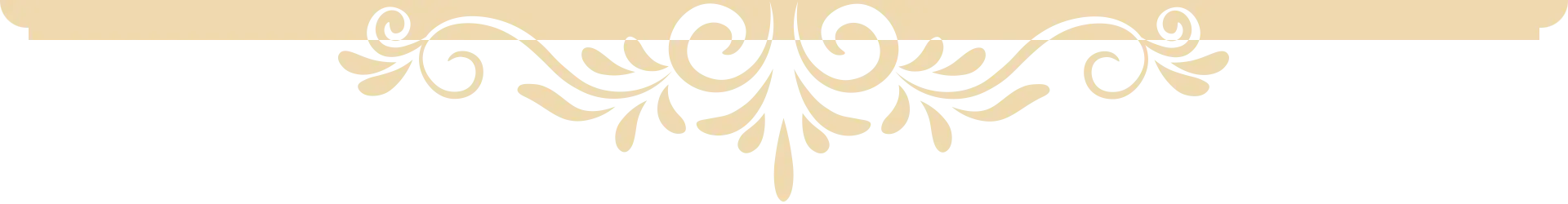
Lire un menu est aujourd’hui un geste banal : on le lit, on choisit. Mais derrière cette évidence se cache une histoire, née dans les cercles du pouvoir et perfectionnée par les plus grands maîtres de la cuisine française. Du faste des tables royales jusqu’à Escoffier, le menu a toujours été bien plus qu’une simple liste de plats : il est un miroir de son époque, un manifeste culinaire, un art à part entière.

Les menus de Choisy
Avant Choisy, le menu n’était qu’un document administratif. Rédigé pour les officiers de bouche et les cuisiniers, il détaillait l’enchaînement des plats à préparer et leur service, mais n’avait aucune vocation décorative ou publique. C’était l’outil de travail des coulisses, pas un objet que l’on posait sur la table.
À Choisy, tout change. Dans cette résidence favorite de Louis XV, les menus se parent d’ornements raffinés : calligraphie élégante, cartouches dorés, aquarelles délicates de fleurs, parfois même des emblèmes royaux. Le menu n’est plus seulement un guide pour le personnel, mais un message de prestige destiné aux invités.
Les intitulés des mets — potages, relevés, entrées, rôtis, entremets — s’alignent comme les actes d’un opéra culinaire. Le texte devient poésie, promesse et mise en appétit. Le menu se lit, se contemple, s’admire.

De la cour à la ville
Avec la Révolution et la disparition des grandes maisons aristocratiques, les talents des anciens cuisiniers de cour se déplacent vers les restaurants naissants. Le menu change alors de fonction : il sort des cuisines pour arriver entre les mains du client.
Les premiers restaurants affichent parfois leurs propositions sur un tableau ou une feuille manuscrite, mais l’idée d’un menu individuel se répand peu à peu. Ce nouveau support offre un luxe inédit : choisir son repas. Là où l’auberge imposait un plat unique à heure fixe, le restaurant permet de composer son dîner, de sélectionner mets et vins, d’adapter le service à ses envies.
Le menu devient un objet de curiosité, un outil de séduction et un argument commercial. On soigne son écriture, on y glisse des descriptions alléchantes, parfois en français, parfois en italien pour flatter le goût cosmopolite de la clientèle huppée. Déjà, il devient un élément du décor et de l’expérience.

Carême et l’art de structurer
Au XIXᵉ siècle, Marie-Antoine Carême, surnommé le « roi des chefs et chef des rois », codifie l’art du menu dans son ouvrage Le maître d’hôtel français : traité des menus (1842). Carême y établit des règles précises sur la composition d’un repas : équilibre entre services, alternance des textures, progression des saveurs.
Pour Carême, le menu est un acte d’architecture culinaire. Il ne se contente pas d’énumérer des plats : il raconte une histoire, crée une montée en puissance, ménage des pauses et des surprises. Carême précise que le choix des mets doit tenir compte de la saison (pour la fraîcheur et la qualité des produits), de l’importance de l’événement, et de l’harmonie visuelle (équilibre des couleurs, symétrie dans la présentation des plats).
Ses menus, conçus pour des banquets diplomatiques comme pour des dîners plus intimes, sont des œuvres d’art éphémères. Il élève cet outil de planification au rang de manifeste esthétique, influençant durablement la gastronomie française.

Escoffier, la précision moderne
Un siècle après Carême, Auguste Escoffier porte l’art du menu à son sommet. Chef visionnaire de la Belle Époque, il allège les cartes surchargées héritées du XIXᵉ siècle, supprime les excès et orchestre la succession des plats avec la rigueur d’un chef d’orchestre.
Pour lui, le menu n’est pas un simple inventaire culinaire : c’est la colonne vertébrale du repas, un outil stratégique qui organise le travail des brigades, planifie les approvisionnements, respecte la saisonnalité et traduit la personnalité de la maison. Pensé comme une partition, il équilibre couleurs, textures et saveurs, séduisant l’œil avant même la première bouchée.
En 1912, il publie Le Livre des menus, un recueil de centaines de propositions adaptées aux saisons, aux clientèles et aux circonstances – du déjeuner intime au banquet officiel. Il y défend la fraîcheur des produits, la précision des associations et le rythme harmonieux du service.
Escoffier sait aussi faire du menu un objet de prestige : il crée des plats pour des convives d’exception, comme la Pêche Melba pour la cantatrice Nellie Melba ou les Crêpes Suzette, selon la légende, pour une dame qui accompagnait le prince de Galles. Chaque intitulé est pesé, chaque mot choisi, chaque saison respectée. Sous sa plume, le menu devient signature du chef et emblème de l’excellence française.
Du secret des cuisines royales à la carte posée sur nos tables, le menu a parcouru un long chemin. Outil d’ordre, manifeste esthétique, promesse de saveurs : il raconte l’histoire de la gastronomie à travers celle de ses plus grands maîtres. Et à chaque fois qu’on le parcourt des yeux, c’est un peu de ce patrimoine que l’on savoure avant même la première bouchée.

Retrouvez les autres articles du blog
Retrouvez les autres articles du blog