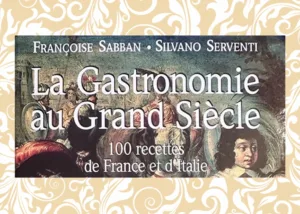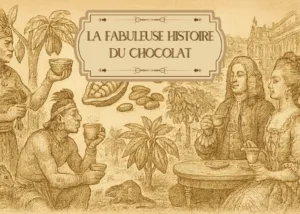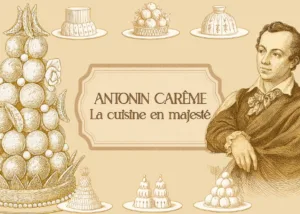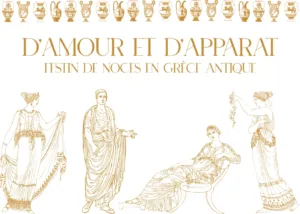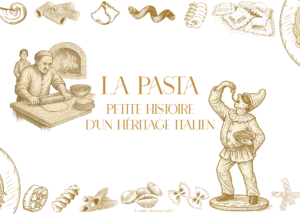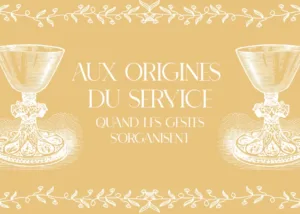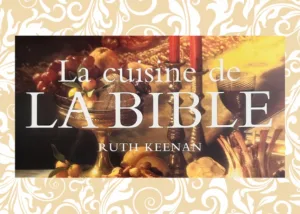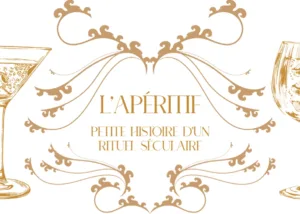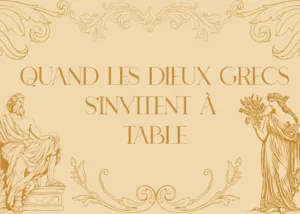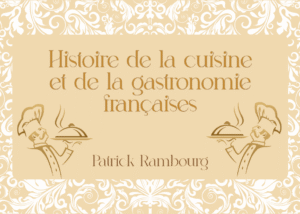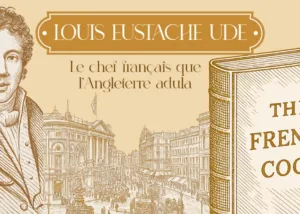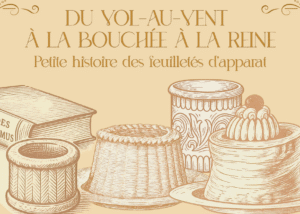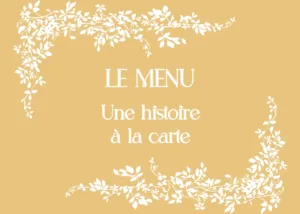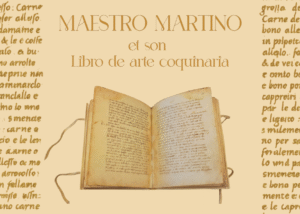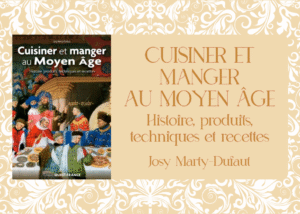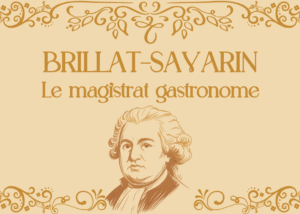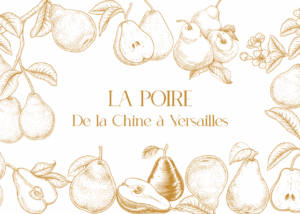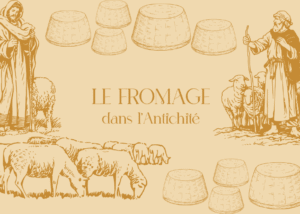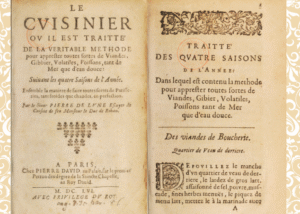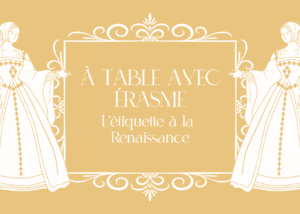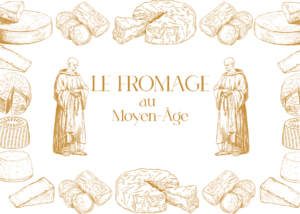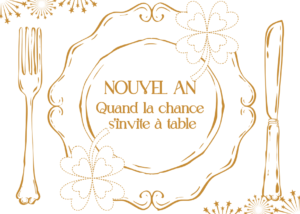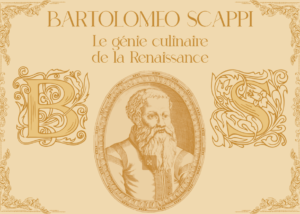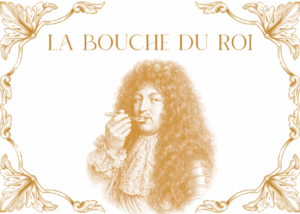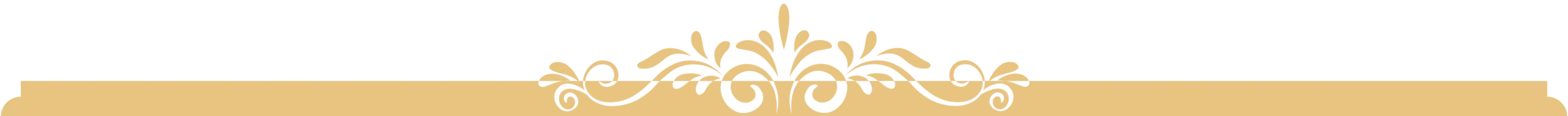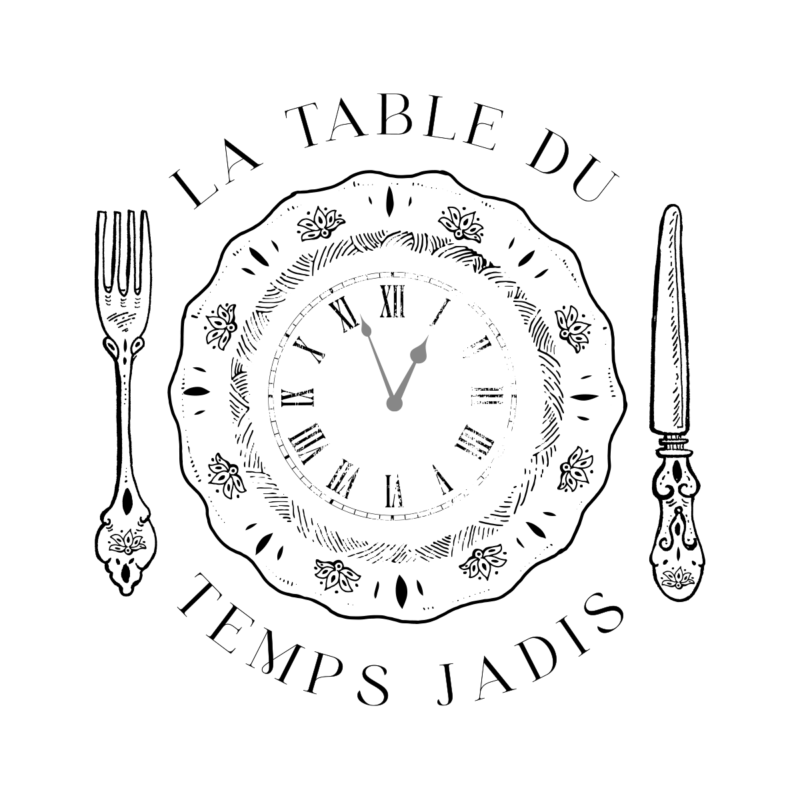Les courges
d’un monde à l’autre
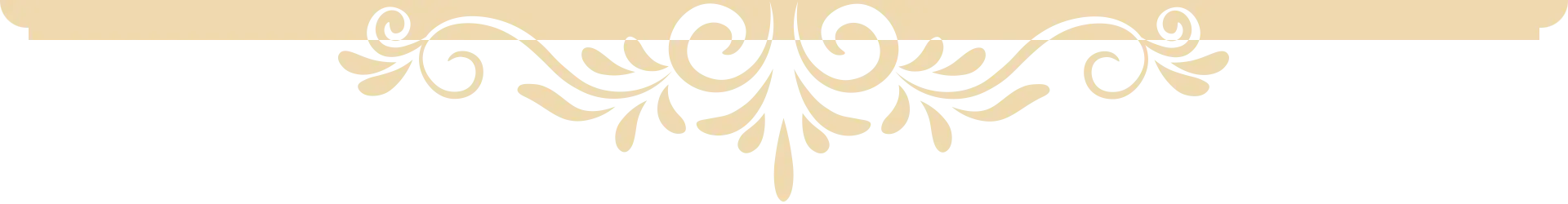
Avec le retour des jours brumeux et des couleurs mordorées de l’automne, citrouilles et courges s’invitent à nouveau dans les potagers et sur les étals. Leur peau orangée capte les derniers rayons de la saison, tandis que leur chair promet douceurs, veloutés et lanternes aux sourires énigmatiques. Derrière leur allure familière se cache une histoire ancienne, tissée de voyages et de traditions.

Dès l’Antiquité, la Lagenaria
Bien avant que les courges venues d’Amérique ne traversent l’Atlantique, le Vieux Continent connaissait déjà la gourde ou Lagenaria. Son nom vient du latin lagena, qui signifie « bouteille » ou « flacon », en référence à sa forme caractéristique. Arrivée en Europe continentale depuis l’Asie méridionale, elle était très prisée.
Les auteurs romains en parlent avec précision. Columelle la mentionne dans ses traités agricoles, tandis que Pline l’Ancien, dans la Naturalis Historia, la compare au concombre pour la manière dont on la cultive. Dans les jardins antiques, elle grimpait le long de treilles, offrant ses fruits allongés aux silhouettes reconnaissables entre toutes. Son goût, proche du concombre, en faisait un ingrédient apprécié dans les préparations simples, rafraîchissantes et digestes. Apicius même lui a consacré un chapitre dans son traité L’Art culinaire (Livre III, chap. IV)
Au Moyen Âge, la Lagenaria reste solidement ancrée dans les pratiques culinaires. Vers 1380, dans le célèbre Viandier de Guillaume Tirel, dit Taillevent, une recette associe la douceur de la courge au lait d’amande et au beurre, révélant un usage raffiné bien antérieur à l’arrivée des courges américaines. Dans la péninsule italienne, Maestro Martino, cuisinier lombard du XVe siècle, propose également une soupe de courge, témoin de la place stable qu’elle occupe dans la gastronomie médiévale.
Contrairement aux variétés américaines, la Lagenaria n’a jamais cessé d’être cultivée et cuisinée en Italie. Des potagers antiques aux cuisines de la Renaissance, elle s’inscrit dans une continuité ininterrompue, mêlant culture domestique et traditions culinaires. Cette présence ancienne crée un terreau idéal pour accueillir, quelques siècles plus tard, les nouvelles venues : les courges du genre Cucurbita.

La Cucurbita américaine
Lorsque les explorateurs européens abordent le continent américain, ils découvrent des courges bien différentes de celles déjà cultivées dans l’Ancien Monde. Ces nouvelles venues appartiennent au genre Cucurbita, originaire du Nouveau Monde, où elles sont domestiquées depuis des millénaires. Des peuples autochtones les cultivent et les sélectionnent, donnant naissance à une extraordinaire diversité de formes, de tailles et de couleurs.
Au XVIᵉ siècle, ces plantes franchissent l’océan dans le sillage des grandes explorations. Elles font partie de ces nombreuses « plantes de la Découverte » qui, avec le maïs, les haricots ou la tomate, bouleversent les jardins et les cuisines du Vieux Continent. Introduites d’abord en Espagne et au Portugal, puis en Italie et en France, elles s’installent dans les clos monastiques, les potagers princiers et les jardins d’agrément. On les admire pour leurs silhouettes inhabituelles et leurs teintes éclatantes, autant qu’on les cultive pour leur générosité nourricière.
Peu à peu, elles gagnent les campagnes françaises, où leur culture s’enracine durablement au rythme des saisons et des terroirs. La Musquée de Provence, sans doute la plus ancienne variété encore cultivée, incarne cette appropriation précoce dans le Midi : sa chair parfumée et ses formes élégantes sont appréciées depuis longtemps. Plus tard, au XIXᵉ siècle, le savoir-faire des maraîchers donne naissance à d’autres variétés qui marqueront durablement le paysage agricole : la Rouge Vif d’Étampes au rouge profond, la Galeuse d’Eysines à la peau bosselée et la Sucrine du Berry viennent enrichir cette mosaïque végétale.
Au XXᵉ siècle, le potimarron, revenu du Japon après un long détour, vient compléter cette famille désormais bien établie. De plantes venues d’ailleurs, les courges sont devenues des compagnes familières des nos campagnes, prêtes à entrer dans nos traditions.

De l’ombre à la table
Si les courges se sont rapidement acclimatées aux jardins européens, leur entrée dans les cuisines s’est faite lentement. Longtemps, elles furent tenues pour des plantes d’appoint, utiles mais secondaires, cultivées en marge des pratiques alimentaires bien établies. Leur chair douce et farineuse séduisait peu les palais aristocratiques, attachés aux légumes familiers et aux recettes codifiées.
Sous Louis XIV, cette réserve se lit clairement. En 1651, François-Pierre de La Varenne, dans son Cuisinier François, ne propose que deux recettes à base de courge. Ce chiffre minime en dit long : dans l’univers aristocratique, ces fruits venus d’Amérique demeurent des curiosités horticoles, admirées pour leurs formes et leurs teintes, mais rarement portées à la table.
Au XVIIIᵉ siècle, la situation évolue peu en France. Dans La Cuisinière bourgeoise (1746), Ménon écrit encore que “les potirons et les citrouilles ne sont d’aucun usage en cuisine, que pour faire de la soupe au lait.” L’intérêt reste faible et la courge conserve l’image d’un légume rustique, sans prestige gastronomique.
En Italie, la situation est tout autre. À la même époque, la courge occupe déjà une place d’honneur à table. Le cuisinier napolitain Vincenzo Corrado, dans son Cuoco galante (1773), lui consacre pas moins de vingt-deux recettes. Une multitude de préparations fines, souvent destinées aux banquets aristocratiques, contrastent fortement avec la relative indifférence française. Même au XIXᵉ siècle, avec Marie-Antoine Carême, la situation reste inchangée : il ne mentionne qu’une seule recette, une simple purée de potiron au velouté.
Ce n’est qu’au XXᵉ siècle que la courge prend une place de choix en France, grâce au potimarron, une variété originaire d’Amérique du Sud, longuement cultivée au Japon avant de revenir en Europe. Avec sa chair dense et sucrée, le potimarron devient un produit d’automne à part entière, célébré dans les cuisines et sur les marchés.

Entre rites et légendes
Avec leurs formes inhabituelles, leurs silhouettes rebondies et leurs teintes éclatantes, les courges ont toujours frappé les esprits. À la fois nourricières et décoratives, elles ont longtemps occupé une place ambivalente : symboles d’abondance et de fécondité, mais aussi de rusticité. Dans les textes anciens comme dans les traditions populaires, elles sont à la fois admirées et tournées en dérision.
Le mot Halloween vient de la forme ancienne Hallowe’en, contraction de All Hallow Even, c’est-à-dire la veille de la Toussaint (All Hallows’ Eve). Cette fête elle-même trouve son origine dans Samhain, une célébration celtique irlandaise qui a vu le jour il y a environ 2 500 ans. Elle marquait le passage de la saison claire à la saison sombre, moment perçu comme une période de transition où les frontières entre les mondes s’effaçaient et où les esprits revenaient hanter les vivants. Les déguisements et les lanternes trouvent leur origine dans ces rituels destinés à éloigner ou tromper les revenants.
La tradition de la lanterne sculptée remonte à une légende irlandaise : celle de Jack O’Lantern, ou « Jack à la lanterne ». Jack, personnage avare et rusé, aurait dupé le Diable à deux reprises, l’obligeant à lui promettre de ne jamais réclamer son âme. À sa mort, rejeté à la fois du paradis et de l’enfer, il erra sans destination. Le Diable, moqueur, lui donna une braise venue des enfers, que Jack plaça dans un navet évidé pour éclairer sa route dans l’obscurité éternelle. Depuis, il rôde entre le monde des vivants et celui des morts, sa lanterne à la main. Lorsque les immigrants irlandais s’installèrent en Amérique au XIXᵉ siècle, ils troquèrent les navets pour des citrouilles, plus grandes et faciles à sculpter. Ainsi, la figure de Jack O’Lantern s’est transformée en emblème lumineux d’Halloween, mêlant légendes celtiques, traditions rurales et une courge venue du Nouveau Monde.
Aujourd’hui, les courges ont retrouvé une nouvelle vitalité. Devenues icônes de l’automne, elles décorent fenêtres et marchés, inspirent cuisiniers et conteurs, mêlant traditions ancestrales et influences venues d’ailleurs. Entre héritages anciens et réinventions contemporaines, elles s’imposent comme des témoins vivants d’un imaginaire qui traverse les siècles.

Retrouvez les autres articles du blog
Retrouvez les autres articles du blog