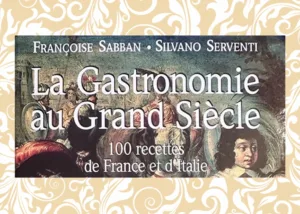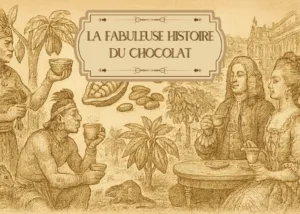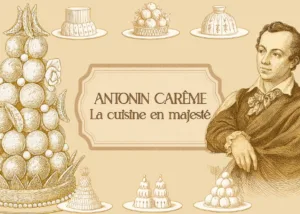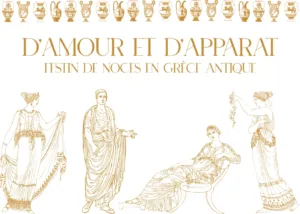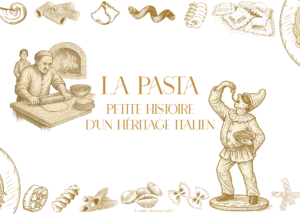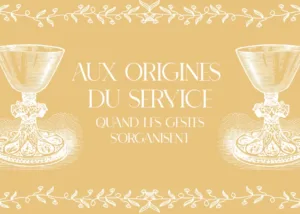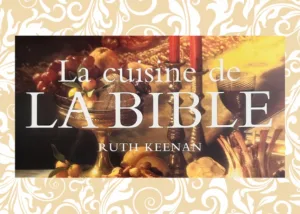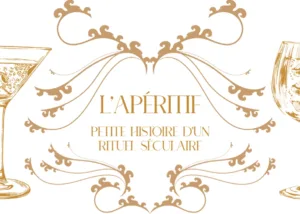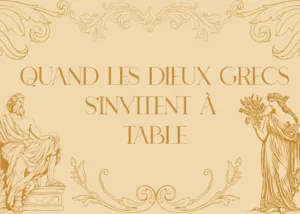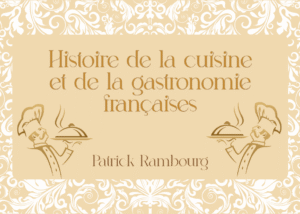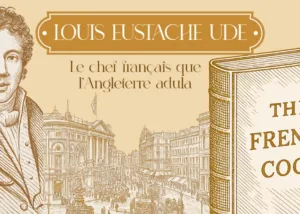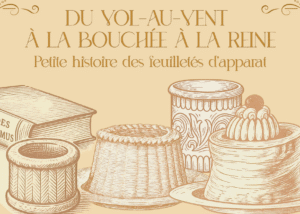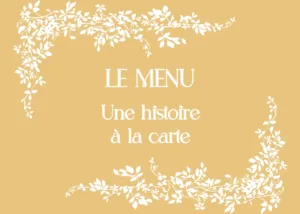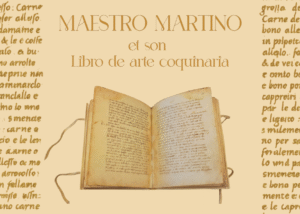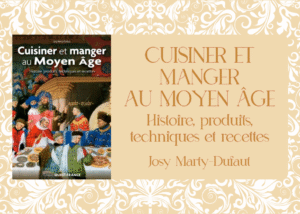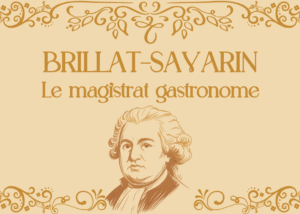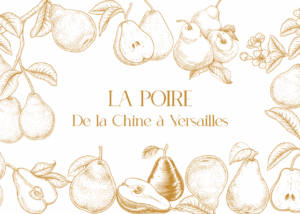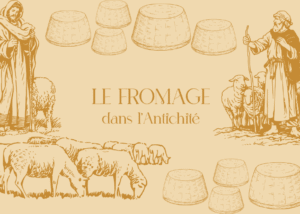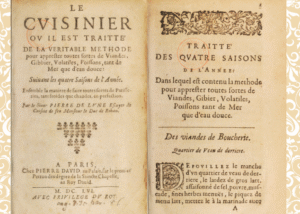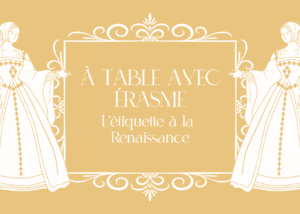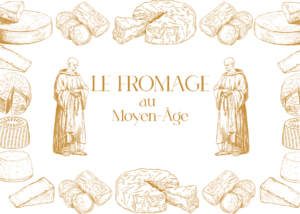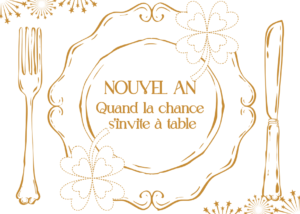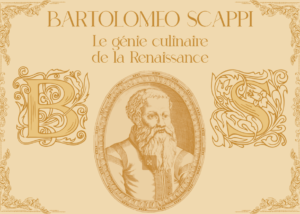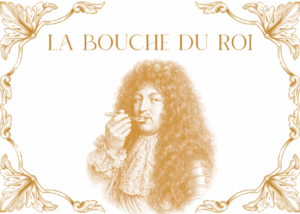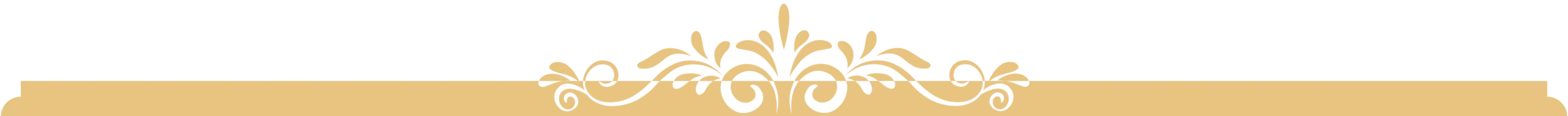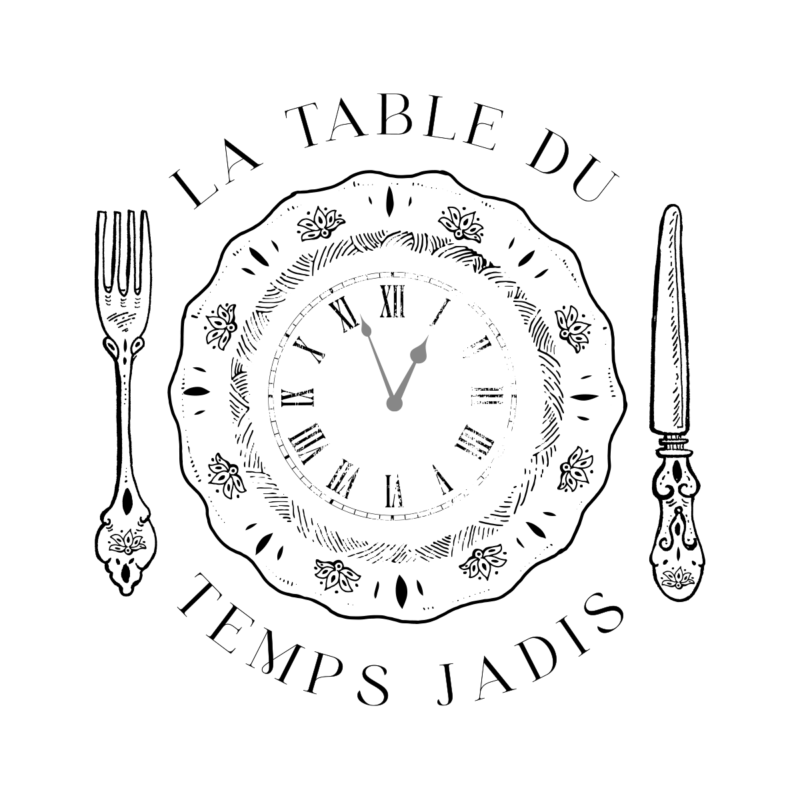Le couvert individuel
Du plat partagé à la table codifiée
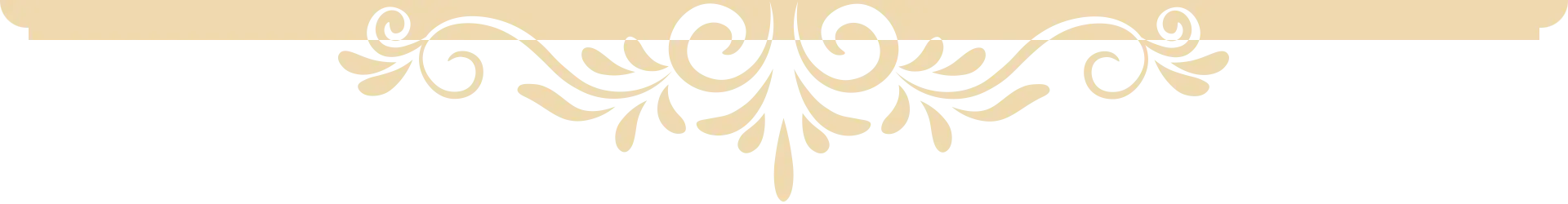
Aujourd’hui, il paraît évident qu’à table, chacun dispose de ses propres couverts. Pourtant, cette évidence est le fruit d’un lent processus historique. L’individualisation des ustensiles – couteaux, cuillères, fourchettes – marque un tournant dans la manière de concevoir le repas. Cette transformation ne se réduit pas à des questions pratiques ou hygiéniques : elle reflète des mutations profondes du rapport au corps, à la nourriture et à la société.

Le temps du plat commun
Jusqu’à la fin du Moyen Âge, le repas est un acte communautaire. On mangeait souvent à plusieurs dans des écuelles partagées, posées sur une planche de bois commune. Les couverts, quand il y en avait, étaient limités : chacun apportait parfois son propre couteau, tandis que les cuillères étaient rares, parfois posées à côté des plats pour se servir. Le pain servait de support, voire d’assiette individuelle. Les doigts faisaient le lien direct entre l’homme et sa nourriture.
Ce moment de partage est aussi un moment de proximité sociale. Les gestes sont francs, les regards se croisent, les conversations accompagnent les bouchées. Manger, c’est plonger la main dans un plat, rompre le pain, échanger. La table reflète alors un monde sans distance, où le rapport au corps est direct, assumé, et où l’intimité collective prévaut sur les codes.

Raffinement aristocratique et mutation des usages
À partir de la seconde moitié du XVIᵉ siècle, la table des élites commence à évoluer. Dans les cours princières et aristocratiques, la multiplication des mets et l’intensification des règles de bienséance favorisent la spécialisation des ustensiles. Ces convives privilégiés disposent désormais de leur propre couvert, avec cuillère, fourchette à trois dents, et parfois plusieurs couteaux selon les mets servis. La pratique s’établit d’abord lors des banquets de représentation, où les couverts deviennent un marqueur de rang.
Mais cette mutation dépasse la question du statut. Elle accompagne une nouvelle manière de concevoir la civilité : on apprend à maîtriser ses gestes, à contenir son corps, à manger sans faire de bruit. La table devient un théâtre du contrôle de soi. Cette individualisation des gestes s’exprime dans la forme même des couverts : plus légers, plus élégants, plus fonctionnels, ils appellent une posture retenue.

La bourgeoisie s’empare des codes
Au XVIIIᵉ siècle, avec l’essor de la bourgeoisie urbaine, ces nouvelles manières se diffusent au-delà des cercles aristocratiques. Les traités de civilité se multiplient et enseignent les bons usages à table, en particulier aux enfants. Avoir ses propres couverts devient un signe d’éducation, de respectabilité.
Le repas, jadis lieu de convivialité ouverte, devient un espace ritualisé et normé. Cette évolution est aussi rendue possible par le développement de la production manufacturière. Des ateliers, puis des usines, fabriquent des couverts standardisés, accessibles à davantage de foyers. La table devient un espace domestique structuré, où chaque convive a son territoire désigné : assiette, serviette, couverts, verre… L’individu s’affirme dans sa place, dans son rôle, dans sa façon de se tenir.

L’invention d’un rituel moderne
Le XIXᵉ siècle consacre le triomphe du couvert individuel. Il s’impose dans tous les milieux sociaux, y compris les plus modestes. Dans les écoles, les pensions, les mess militaires ou religieux, chacun apprend à manger “à la française”, avec une cuillère, une fourchette et un couteau bien tenus. La disposition des couverts devient un code universel, enseigné, reproduit, transmis.
Derrière cette évolution se joue un changement de société : l’individualisme moderne prend forme. À table comme ailleurs, on apprend à se penser comme sujet autonome, doté de droits, d’espace et de responsabilités. Manger avec ses propres couverts, c’est aussi affirmer une frontière : entre soi et les autres, entre l’intime et le public. C’est refuser le plat commun, pour préférer un repas plus distancié, plus policé – plus “moderne”, dirait-on.
.
L’histoire du couvert individuel est celle d’une lente séparation : de la main collective vers le geste personnel, du plat partagé à l’assiette ordonnée. Bien plus qu’une affaire d’ustensiles, c’est toute une vision du monde qui bascule. Le repas devient un rituel réglé, une mise en scène du soi civilisé.
En cela, l’individualisation des couverts raconte l’émergence d’un nouveau rapport à l’autre, au corps et à la société – jusque dans nos gestes les plus quotidiens.

Retrouvez les autres articles du blog
Retrouvez les autres articles du blog