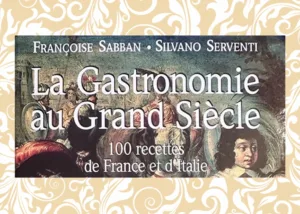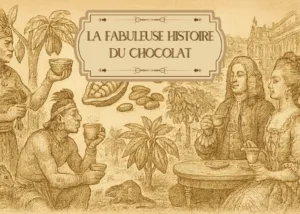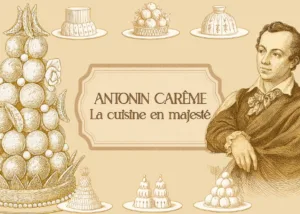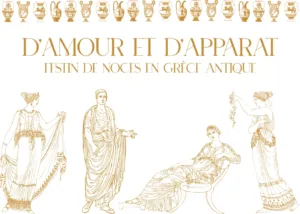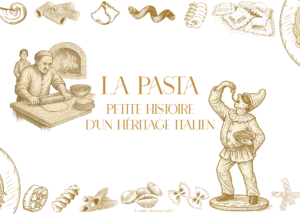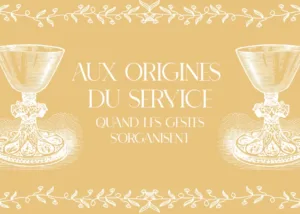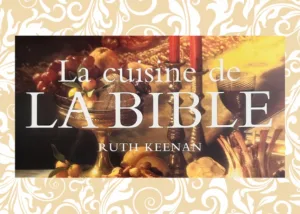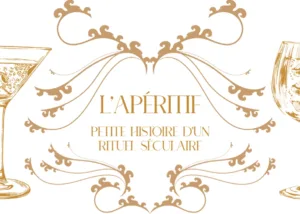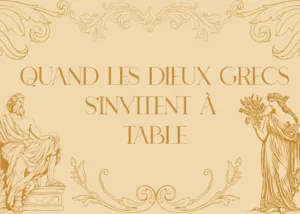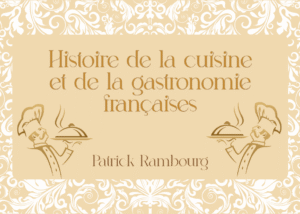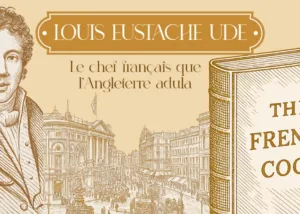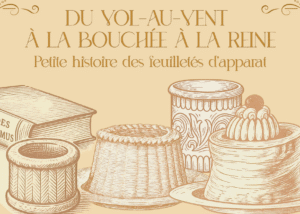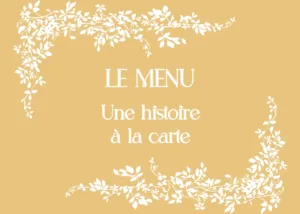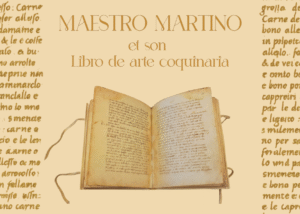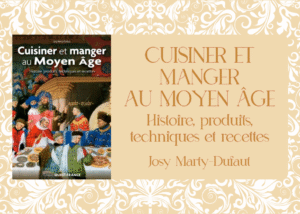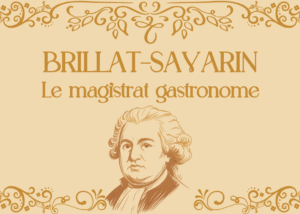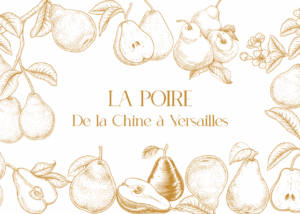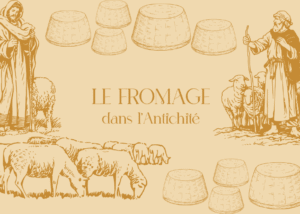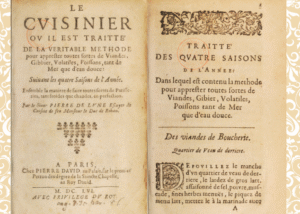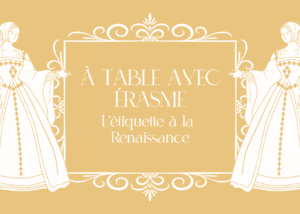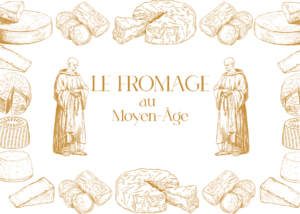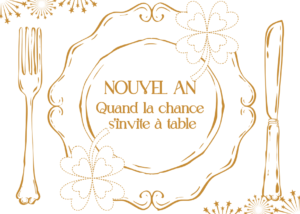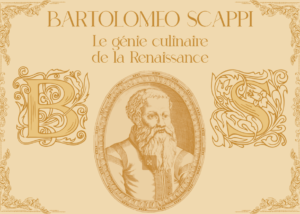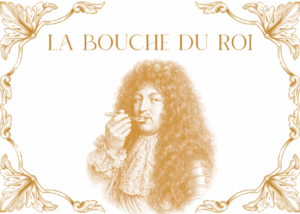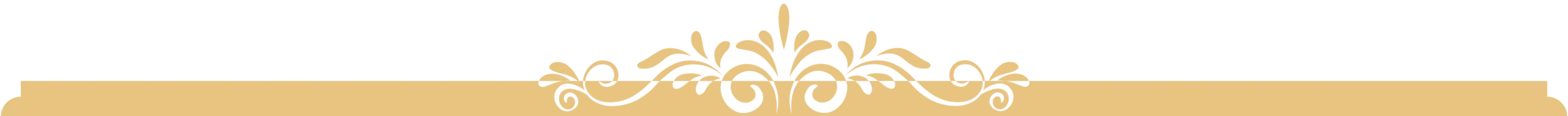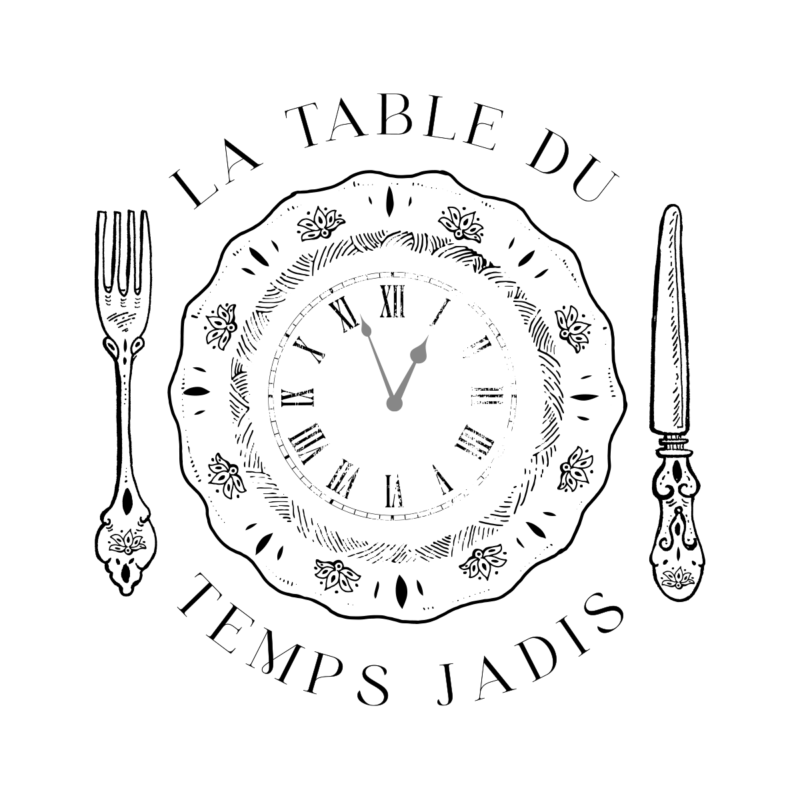La serviette de table
de la mappa romaine à l’étiquette de Versailles
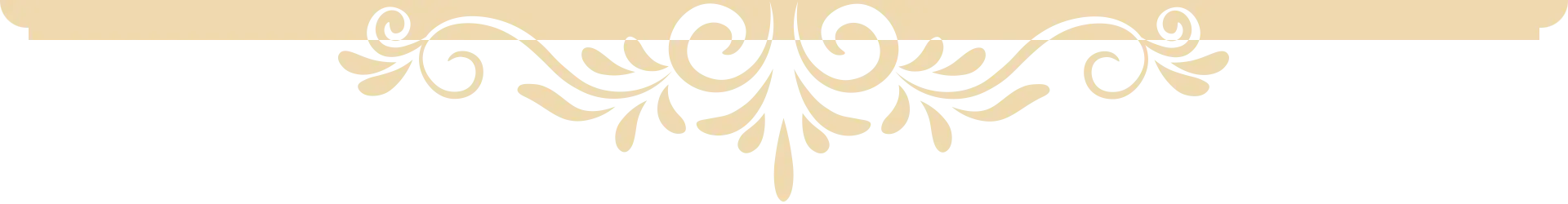
Discrète sur nos tables, la serviette a pourtant une histoire fascinante. De l’Antiquité où l’on s’essuyait avec du pain ou du foin, à la Renaissance où elle protège les fraises démesurées d’Henri III, jusqu’aux pliages savants du Grand Siècle, elle n’a cessé de refléter l’évolution des manières de table. Bien plus qu’un linge, elle incarne propreté, civilité et ostentation.

L’Antiquité : de l’apomagdalie à la mappa
L’idée de se munir d’un linge à table n’est pas moderne : elle remonte à l’Antiquité, mais sous des formes encore surprenantes. Les Spartiates utilisaient des morceaux de mie de pain (apomagdalie) pour s’essuyer les doigts. Les Celtes se contentaient de poignées de foin, vite jetées après usage.
À Rome, où l’on mangeait allongé sur des lits triclinaires, il arrivait que l’on s’essuie directement sur les draps, ou sur un pan de sa tunique. Mais dès le Ier siècle, une véritable innovation apparaît : la mappa. Chaque convive apporte ce linge personnel, généralement en lin blanc, parfois orné de broderies de couleur ou de fils d’or. Elle sert d’abord à protéger la toge des taches, mais aussi à recueillir les mets que l’hôte offre en fin de banquet. On y enveloppe les restes, que l’on rapporte chez soi en signe d’hospitalité. Ancêtre du doggy bag La mappa devient ainsi un objet d’hygiène, de distinction sociale et de générosité. Toutefois, son usage n’est pas universel : dans bien des contextes, on continue de s’essuyer sur la nappe commune.
Après la chute de l’Empire, la serviette individuelle disparaît, et il faudra attendre plusieurs siècles pour qu’elle renaisse dans les cours européennes.

Le Moyen Âge : de la nappe à la touaille
La table médiévale s’organise autour d’un seul linge : la nappe. Dès le haut Moyen Âge, elle couvre la table des monastères et des cours princières. Elle protège la planche, apporte solennité au repas et sert aussi à s’essuyer les doigts. L’idée d’une serviette individuelle paraît encore étrangère : la nappe suffit, et son usage collectif ne choque personne, même dans les milieux aristocratiques.
À partir du XIIᵉ siècle, apparaissent des dispositifs plus élaborés. Le doublier est une nappe pliée en deux : la partie supérieure reçoit les mets, l’autre, restée propre, sert à l’essuyage. Au siècle suivant, on voit se développer la longuière, une bande de tissu cousue ou simplement disposée en bordure de table, sur laquelle les convives essuient leurs doigts graisseux. Enfin, au XIVᵉ siècle, la touaille s’impose dans les banquets raffinés : un grand linge suspendu près de la table ou porté par les serviteurs, utilisé successivement par plusieurs convives.
Ces formes montrent une recherche croissante d’organisation et de propreté, sans pour autant individualiser le linge. Dans certains festins, deux voisins partagent encore la même pièce de tissu. Il faut attendre la fin du Moyen Âge, au XIVᵉ–XVe siècle, pour que réapparaisse la serviette personnelle, dans les cours princières, comme signe de distinction et de civilité.

L’extravagance de la Renaissance
À la Renaissance, la serviette retrouve un rôle central dans l’art de la table. Elle est redevenue individuelle et prend des dimensions impressionnantes, parfois proches d’un mètre carré. Dans les cours princières, elle n’est plus seulement utilitaire mais participe au décor. On la plie avec soin, parfois en formes raffinées destinées à étonner les convives : corbeilles, fleurs ou animaux stylisés. Certaines sont même parfumées à l’eau de rose, renforçant l’effet de luxe et d’élégance.
La mode vestimentaire accentue encore son importance. Dans les années 1580, sous le règne d’Henri III, triomphe la fraise à plateau, un immense col empesé d’amidon qui s’étale comme un disque autour du cou, atteignant parfois quarante centimètres de diamètre. Avec un tel carcan, porter un mets à la bouche relève de l’exploit. Pour protéger la blancheur de ces collerettes, on noue alors la serviette autour du cou. Certaines étaient si vastes que les pans ne pouvaient même pas se rejoindre. C’est de là que viendrait l’expression « ne pas joindre les deux bouts », qui a pris ensuite un sens très différent.
Ainsi, au XVIᵉ siècle, la serviette illustre à la fois le goût pour le spectacle, l’adaptation aux contraintes de la mode et le besoin croissant de civilité. Elle s’affirme comme un accessoire à part entière du repas, au même titre que la vaisselle précieuse ou les mets raffinés.

Le Grand Siècle : Versailles et l’étiquette
Au XVIIe siècle, la serviette devient indissociable du cérémonial de table. À Versailles, chaque repas est un spectacle réglé comme une cérémonie, et le linge participe à cette mise en scène. Les convives ne l’attachent plus autour du cou, comme à la Renaissance, mais le déplient pour la poser sur leurs genoux.
Les manuels de bienséance, tels que le Nouveau traité de la civilité d’Antoine de Courtin (1671), précisent alors la manière correcte d’utiliser la serviette : posée sur les genoux, employée avec retenue, et jamais agitée ni attachée autour du cou.
Parallèlement, l’art du pliage atteint un degré de sophistication inédit. En 1629, Matthia Giegher, maître d’hôtel de l’évêque de Brixen, publie Li Tre Trattati, premier traité entièrement consacré à la table. Il y décrit avec précision des dizaines de pliages : cygnes, fleurs, couronnes… La serviette devient alors sculpture textile, preuve de la virtuosité du service autant que de la richesse du maître de maison.
La serviette incarne à la fois l’étiquette, l’art décoratif et le prestige textile et devient un objet indispensable du raffinement à table.
Depuis le Grand Siècle, la serviette a changé de rôle : les pliages spectaculaires se sont effacés, mais le soin porté au linge demeure. Jadis signe de prestige, elle reste aujourd’hui un marqueur de raffinement, déclinée en tissus et couleurs variés.
Discrète mais essentielle, elle perpétue un héritage d’élégance qui traverse les siècles et continue d’accompagner nos repas.

Retrouvez les autres articles du blog
Retrouvez les autres articles du blog