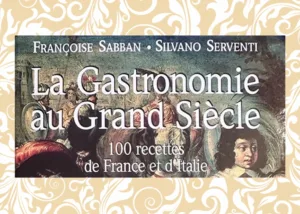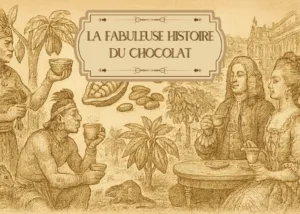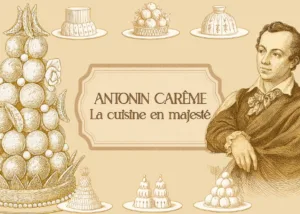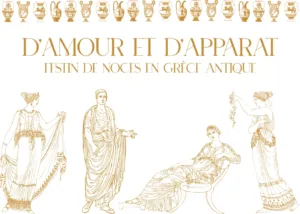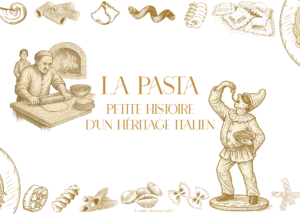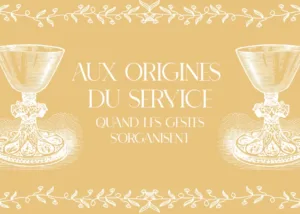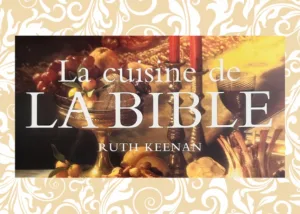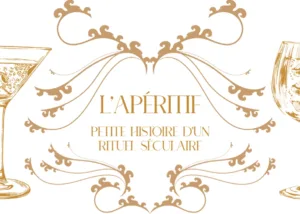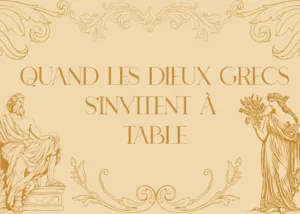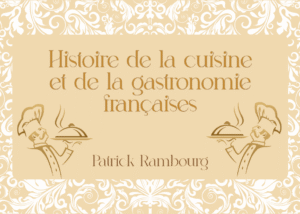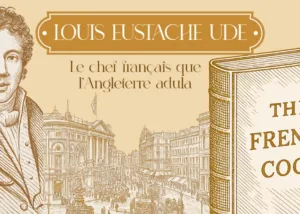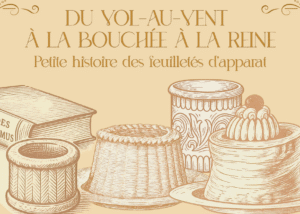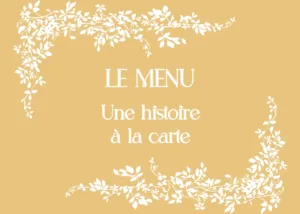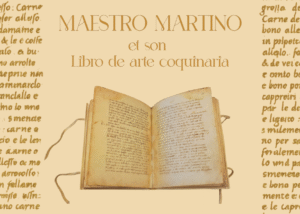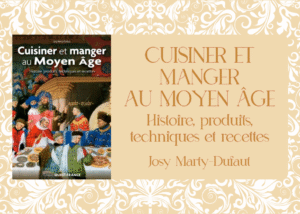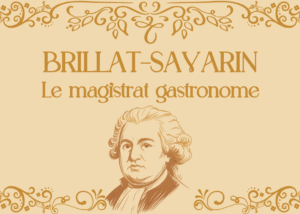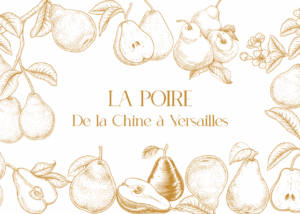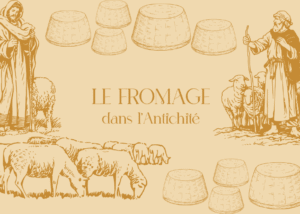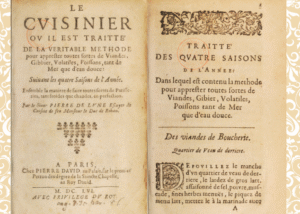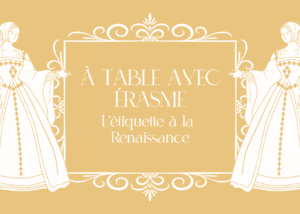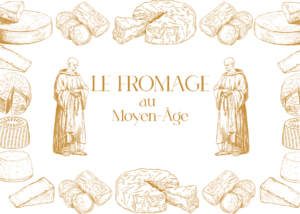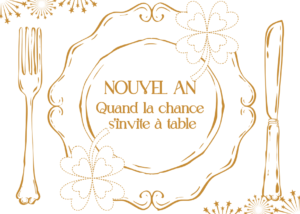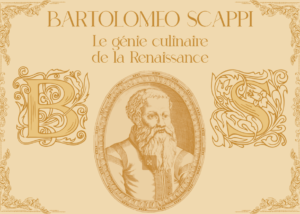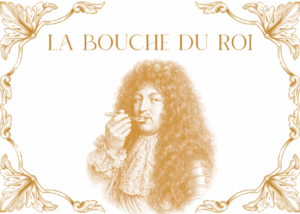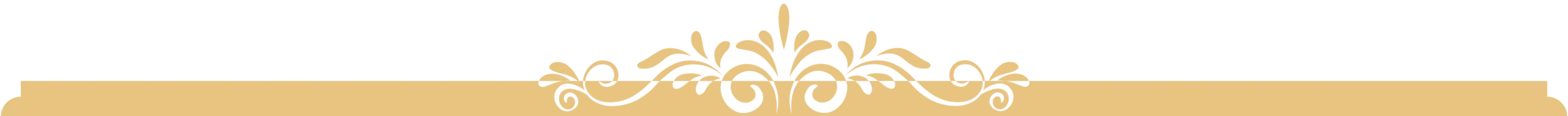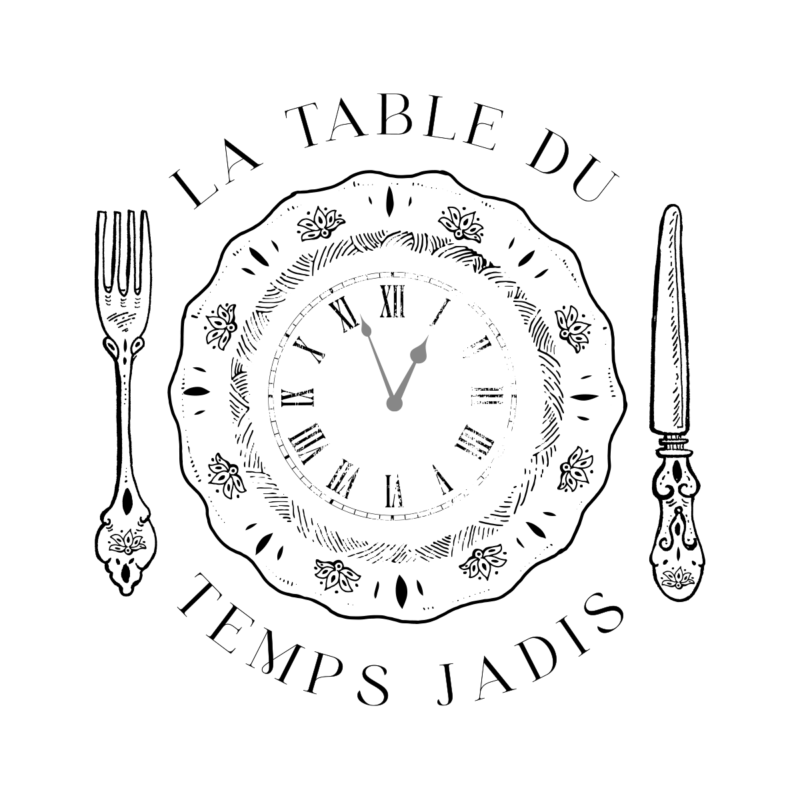Du vol-au-vent à la bouchée à la reine
Petite histoire des feuilletés d’apparat
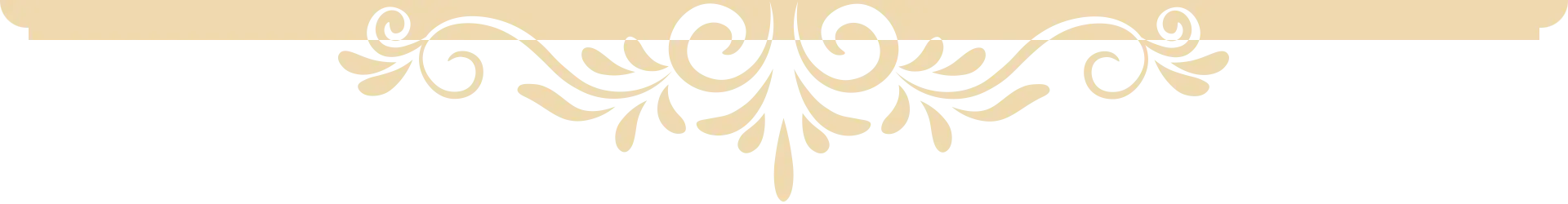
Léger comme l’air, délicat comme un souffle : le vol-au-vent charme d’abord par son nom. Mais cette élégante pâtisserie feuilletée a connu bien des métamorphoses avant de devenir un classique des repas dominicaux. Entre menus d’apparat, garnitures fastueuses et douceurs oubliées, son histoire est tout sauf éthérée.

Vole-au-vent : une expression avant l’heure
Non, Antonin Carême n’a pas inventé le vol-au-vent. Dès 1739, on trouve dans des menus la mention de « petits gâteaux vole au vent ». En 1742, François Marin en donne une recette dans La Suite des dons de Comus. On y façonne la pâte feuilletée en forme de losange ou d’équerre, on la dore légèrement à l’œuf, on la cuit à feu doux, et on la sert chaude. Le feuilletage y est essentiel, signe de légèreté. Pourtant, le nom « vole au vent » s’applique alors à des préparations très diverses. En 1755, Menon propose dans Les Soupers de la cour des « ramequins vole-au-vent » faits de fromage de Brie fondu avec du beurre, de la farine, des jaunes d’œufs et des blancs en neige. L’ensemble est divisé en petites portions, que l’on place « entre deux petites abaisses très minces de feuilletage », dorées et cuites un quart d’heure au four. Menon évoque aussi un « massepain vole au vent » à base d’amandes et de sucre. Au XVIIIe siècle, « vole au vent » désigne moins une recette qu’une idée : celle d’une préparation aérienne, croustillante, raffinée. Une expression sensorielle, avant même d’être culinaire.

Du nom poétique à la forme codifiée
Le mot s’enracine, mais sa forme se précise au XIXe siècle. Dans Le Pâtissier royal parisien (1815), Antonin Carême codifie le vol-au-vent : une pâte feuilletée montée en cylindre, évidée, coiffée d’un couvercle découpé au couteau. On la cuit à four « modéré » jusqu’à obtenir une belle teinte rougeâtre, puis on la vide pour la garnir d’un salpicon — ces petits morceaux d’abats, de volailles ou de légumes liés par une sauce. Le « vol-au-vent à la Nesle » mêle crêtes et rognons de coq, ris d’agneau, quenelles, champignons, queues d’écrevisses, truffes, cervelles et sauce blanche.
Le Dictionnaire de la langue française d’Émile Littré (1874) définit le vol-au-vent comme une « pâtisserie feuilletée, à bords élevés, dans laquelle on met de la viande ou du poisson, et qui se sert chaude ». Le nom évoque sa légèreté, issue du feuilletage.
Une anecdote, rapportée par Jules Fabre dans son Dictionnaire de cuisine, raconte que Carême, en testant une nouvelle manière de monter ses tourtes, aurait demandé à un fournier de surveiller une pâte marquée d’un signe spécial. Celle-ci aurait levé si haut que le fournier se serait exclamé : « Antonin !… elle vole au vent ! ». Carême, émerveillé, aurait ainsi baptisé sa création. Mais cette légende, bien que savoureuse, demeure non attestée : l’expression existait déjà près d’un demi-siècle avant sa naissance.

De la haute cuisine à la tradition bourgeoise
Sous le Premier Empire, le vol-au-vent brille sur les cartes des grandes tables parisiennes. On le décline au turbot à la crème, à la macédoine, à la financière. En 1806, il figure déjà dans des menus publiés. En 1850, le restaurant de l’Hôtel de France à Nantes en propose onze variantes !
Le vol-au-vent devient aussi un classique des repas dominicaux bourgeois : la croûte feuilletée, achetée chez le pâtissier, est garnie à la maison ou chez le traiteur. La version “à la financière” — quenelles, crêtes, rognons de coq, ris, champignons, truffes, olives — serait issue de la finanziera piémontaise, spécialité turinoise passée en France.
Auguste Escoffier, au tournant du XXe siècle, décline les bouchées selon les occasions : à la Diane, au Grand-Duc, à la Montglas, à la Victoria, à la Nantua…
La bouchée à la reine, plus petite portion, circule en parallèle. Elle partage souvent les mêmes garnitures. Une chronique contemporaine de Jean-Loup Chiflet, dans Le Figaro, distingue la bouchée comme un plaisir individuel et le vol-au-vent comme un mets à partager — une perception moderne, non systématique dans les sources anciennes.

La bouchée à la reine : un feuilleté royal devenu classique
Dès 1749, Menon évoque des « petits pâtés à la reine » garnis de godiveau et nappés de coulis. Mais c’est Grimod de La Reynière qui, en 1808, dans L’Almanach des Gourmands, mentionne explicitement les « petites bouchées à la reine » et les associe à Marie Leszczynska, épouse de Louis XV. Il en fait une création délicate, reflet de la piété gourmande de la souveraine.
Avec le temps, la garniture de béatilles (ris, crêtes, rognons de coq, cervelles, truffes, champignons) s’estompe au profit de compositions plus douces. Pour Bouvilliers, elles sont remplies de blancs de volaille liés à une béchamel bouillante. En 1815, Carême les classe comme entrées chaudes, qu’il présente comme de petits vol-au-vent, aux garnitures multiples, y compris aux poissons. Il distingue aussi les petits vol-au-vent sucrés, farcis de crème plombière, café ou autres parfums.
Une autre légende, non attestée, évoque Marie Leszczynska demandant à Nicolas Stohrer de créer une version salée des puits d’amour imaginés par Vincent La Chapelle. La reine aurait voulu éveiller les sens de son royal époux, en transformant un entremets sucré en bouchée chaude et parfumée. Si ce récit relève davantage du roman que de l’histoire, il nourrit l’aura durable de la bouchée à la reine.
À travers ses formes et ses époques, le vol-au-vent demeure un monument de finesse et d’ingéniosité culinaire. Plat de fête ou souvenir d’enfance, il incarne cette alliance rare entre architecture et gourmandise, tradition et invention. Il est toujours là — prêt à s’envoler… pour qui sait l’accueillir.

Retrouvez les autres articles du blog
Retrouvez les autres articles du blog